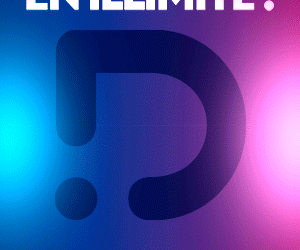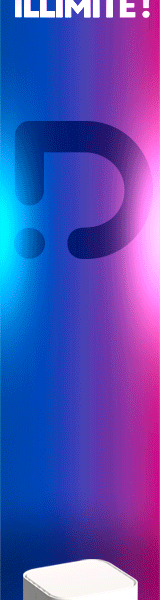One Shark : mieux comprendre les requins-tigres pour protéger les Saint-Martinois
À l’instar du film Les dents de la mer, les requins ont la mauvaise réputation d’être de dangereux prédateurs, prêts à dévorer chaque nageur inconscient qui s’aventurerait trop loin de la côte. Mais qu’en est-il vraiment ? Après deux morsures consécutives en décembre 2020 à la Baie Orientale et en janvier 2021 à Saint Kitts, par ce qui est un seul et même requin-tigre, l’État et la Collectivité de Saint-Martin ont décidé d’engager une étude afin d’améliorer la connaissance de ces squales. Le but ? Estimer leur nombre, comprendre leurs migrations et cataloguer leur profil génétique pour permettre une gestion du risque des morsures de prédation de façon viable, aussi bien économiquement et écologiquement.
D’abord un projet, One Shark s’est transformé en groupement d’intérêt public (GIP), il y a un an, pour structurer tous les acteurs locaux et permettre une dynamique incluant l’État» explique Hadrien Bidenbach, chargé de mission et directeur du GIP regroupant la préfecture, la Collectivité, l’AGRNSM, l’ordre des médecins de Saint-Martin, Metimer, Swali Fishermen et ATE.
One Shark se concentre uniquement sur le requin-tigre, seul à pouvoir être potentiellement dangereux pour l’homme à Saint-Martin. Sous la direction du docteur Éric Clua, vétérinaire et expert international des requins, le GIP se base sur la théorie selon laquelle, parmi toutes les populations de requins, seuls quelques individus peuvent être source de problème et s’attaquer à l’homme dans un but de prédation. Cette hypothèse suggère que la densité de requins n’a qu’une influence très secondaire et dépend essentiellement de la présence, au sein d’une population, d’une infime quantité d’animaux ayant développé un comportement atypique par rapport à la quasi-totalité de leurs congénères, qui eux ne considèreront jamais l’homme comme une proie potentielle. Une hypothèse qui explique aussi pourquoi, en règle générale, les pêches de régulation à l’aveugle échouent, par leur manque de sélectivité. Pour preuve, l’île de la Réunion, pour laquelle ce mode opératoire a eu un impact écologique et économique catastrophique, avec une amplification de la peur sans pour autant faire baisser le risque. Après avoir soutenu cette hypothèse pendant des années, le chercheur Éric Clua est parvenu à apporter les premières preuves de la véracité de ses recherches, dans un article publié début novembre par la revue scientifique Conservation Letters.
À Saint-Martin, le travail de One Shark se répartit sur quatre axes principaux. En numéro un, la diminution du risque pour les usagers avec la création d’un fichier génétique, un protocole post-morsure et un réseau régional. Pour cela, Hadrien et son équipe sortent en mer plusieurs jours d’affilée. « On commence les pêches très tôt, à partir de 4h du matin. On pose les lignes deux heures avant le lever du soleil (…). Une fois un requin-tigre hameçonné (…), on lui pose différents tags afin de pouvoir l’identifier par la suite. On pose un tag en plastique juste derrière l’aileron avec un numéro dessus et un code-barres couleur unique, on implante une puce et on prélève aussi des échantillons d'ADN sur la dorsale en faisant des encoches avec une pince, lui donnant une forme unique» explique le directeur du GIP.
En numéro deux, l’amélioration de la perception des requins. «Cela passe par des communications publiques, des formations auprès de professionnels de la mer ou des discussions auprès des institutions comme les pompiers ou les gendarmes. Pour les touristes également, afin de leur inculquer les bonnes pratiques, comme celle d’aller nager à deux quand on s’éloigne du bord. Le requin est un prédateur qui jauge le risque, de la même façon que nous n’irions pas donner un coup de pied à un chien dans la rue, on irait encore moins le faire à deux chiens» détaille Hadrien.
Troisième axe, l’amélioration de la connaissance et des services de secours. «On donne des formations de secours avec des médecins, aux professionnels qui encadrent les touristes en mer, aux personnes qui travaillent proche du littoral ou encore aux institutions et aux écoles», explique Hadrien.
Dernier axe, celui de la connaissance scientifique, le sujet de la thèse qu’Hadrien réalise avec le GIP. «Les questions sont de savoir, combien de requins il y a dans la zone, qui ils sont, par leur comportement et par la génétique ainsi que de pouvoir les localiser avec les balises GPS», précise-t-il. Ces quatre axes sont travaillés en même temps et interagissent les uns avec les autres.
Pour l’instant, la base de données s’élève à 77 individus dans les Antilles, ce qui la classe comme l’une des plus grosses bases de données d’ADN de requin-tigre mondiale. Dans un futur proche, Hadrien espère intégrer d’autres membres aux GIP, tels que les acteurs du tourisme, la gendarmerie, les pompiers, l'agence régionale de santé, les affaires maritimes ou encore la SNSM. En parallèle de ses actions de routine, il souhaite également augmenter la fréquence des présentations publiques et des formations, en se concentrant notamment sur le milieu scolaire, très en demande.
Crédits photos : Daniel Norwood et Hadrien Bidenbach